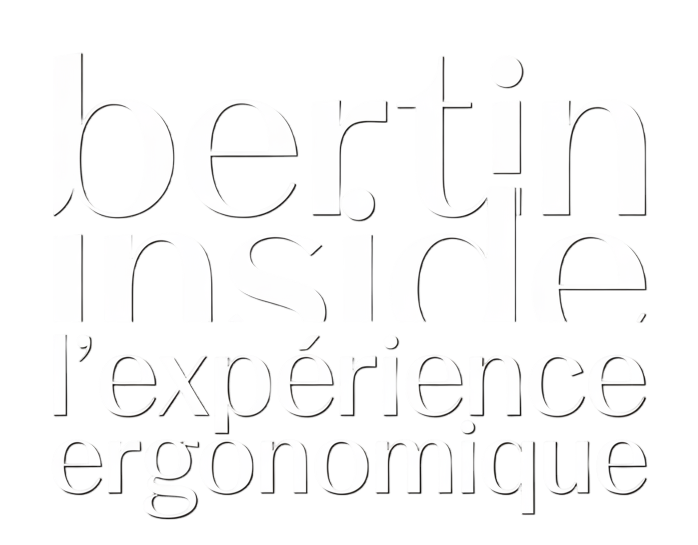Pourquoi l’ergonomie de bureau est-elle, encore aujourd’hui, un impensé du design ?
Observer un open-space, c’est souvent constater à quel point le poste de travail de bureau reste prisonnier de stéréotypes. Tables clonées, chaises uniformes, écrans standardisés, solutions « de confort » réduites au choix d’un fauteuil « prétendument ergonomique »… La disruption numérique a fait entrer les tablettes, doubles écrans et plateformes collaboratives dans nos quotidiens, mais la posture et l’usage, eux, semblent rester figés.
Dans les entreprises françaises, près de 20 % des salariés souffrent de troubles musculosquelettiques (TMS) liés au travail sur écran (INRS, 2021). Les impacts ne sont pas seulement physiques : fatigue cognitive, perte d’attention, tensions psychosociales, sentiment d’aliénation face à un environnement normé, parfois même « hostile ».
Mais au-delà des chiffres, l’ergonomie du bureau pose une question politique : pourquoi, alors qu’un individu adulte passera en moyenne plus de 80 000 heures de sa vie professionnelle assis à un poste de travail (« Sitting time in the workplace », Church et al., 2011), l’humain est-il si peu – ou si tardivement – pris en compte dans la conception même de son espace de travail ?