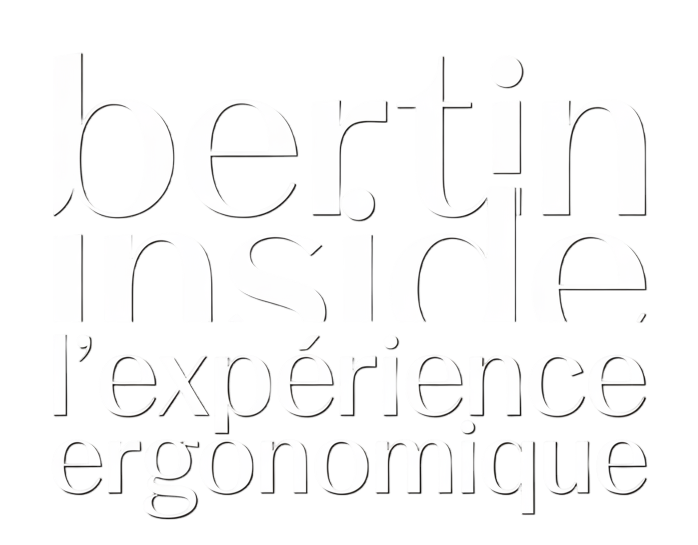Confort et sécurité : les apports concrets de l’ergonomie en résidence seniors
Réduire le risque de chute et de blessure
La chute est la première cause d’accidents mortels chez les personnes âgées après 65 ans (Santé publique France, 2022). L’ergonomie permet de concevoir des espaces plus sûrs :
- Sol antidérapant et marqueurs visuels pour les zones de passage.
- Barres d’appui discrètes mais accessibles dans les sanitaires.
- Mobilier à coins arrondis, poignées ergonomiques, portes faciles à ouvrir.
Le simple fait d’augmenter la largeur des passages et de placer des rampes à des positions clés peut réduire de manière significative le nombre d’accidents. L’Assurance Maladie note que les résidences adaptées ergonomiquement affichent un taux de chutes annuelles inférieur de 35% en moyenne.
Faciliter l’accessibilité et l’autonomie
Les seniors ne présentent pas tous les mêmes besoins. L’enjeu pour les concepteurs de résidences : offrir un environnement adaptable. Un rapport de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) met en avant plusieurs points d’attention :
- Hauteur modulable des plans de travail et des lavabos.
- Fauteuils à accoudoirs rehaussés pour une meilleure assise.
- Porte large, sans seuil, facilitant le passage d’un déambulateur.
Cette accessibilité accrue offre un bénéfice direct : maintien de l’indépendance pour les gestes de la vie quotidienne (toilette, cuisine, déplacements dans la chambre…).
Améliorer la qualité du sommeil et de la détente
La qualité du sommeil influence fortement la santé des seniors. Une étude de l’INSERM souligne que la lumière, le bruit et le confort du mobilier jouent sur le sommeil des résidents. L’ergonomie propose des solutions :
- Lits adaptés en hauteur, sommiers motorisés pour éviter les efforts inutiles.
- Volets automatiques pour gérer la luminosité sans effort.
- Dispositifs d’éclairage nocturne doux et balisage des trajets vers les sanitaires.
Une optimisation de l’éclairage, par exemple, réduit de 60% le nombre de réveils nocturnes liés à une difficulté de repérage (source : Éclairage et Santé – AFE, 2021).